
ROBERT BADINTER : Juif et Français, deux termes d'une condition indivisible
Par Robert Badinter | 09 octobre 2025
Ajouter
Partager
J’aime
À Robert Badinter la patrie reconnaissante.
En 1980, un an avant de porter à la tribune de l’Assemblée la loi abolissant la peine de mort, il répondait pour L'Arche à la question : "que signifie pour vous être juif ?".
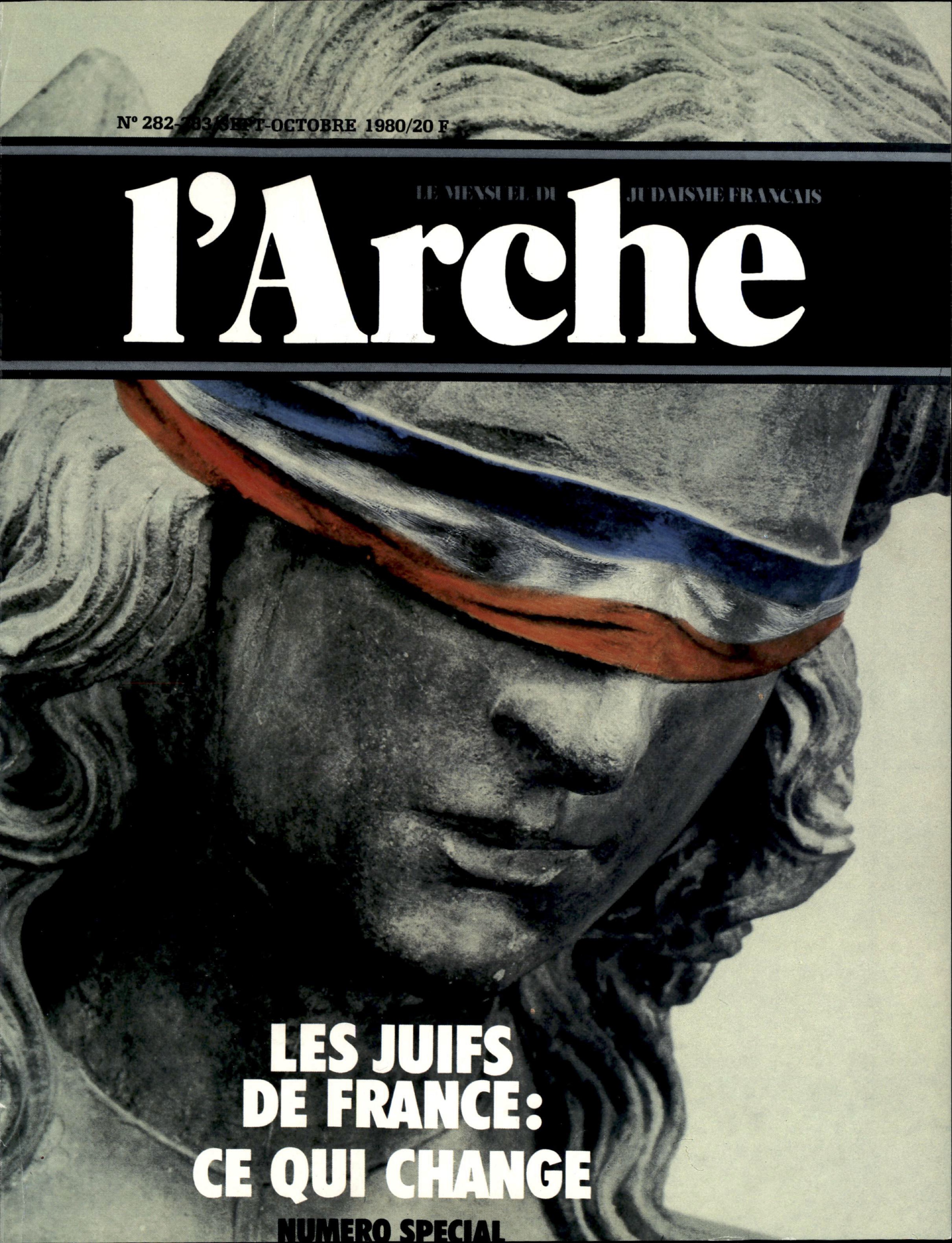
Revue de L'Arche de septembre/octobre 1980
On a noté au cours des récentes années l'émergence du judaïsme français dans la vie de la cité. Des événements comme l'élection du grand rabbin, l'affaire Primor, les tensions internes, les revendications séfarades - naguère confinés dans l'enceinte des institutions - ont été portés sur la place publique. Comment apparaît la communauté juive ? Quels sont les traits qui la caractérisent au sein de la diversité française et dans le mouvement général du réveil des cultures régionales ? L'Arche a ouvert une enquête auprès d'un certain nombre de personnes que ce sujet touche de près ou qui sy intéressent, du dehors, en tant qu'observateurs de la scène politique et sociale. Ils nous apportent ici des témoignages et des analyses parfois divergentes mais qui permettent de mieux cerner une réalité complexe et difficile à saisir parce que mouvante et mal cristallisée.
Je ne me sens pas Juif en France, tant le propos me paraît ambigu, évoquant la simple localisation ou domiciliation. Je m'éprouve Juif de France, Juif français les jours où ma judéité me fait mettre l'accent sur le premier terme d'une condition indivisible : quand les Juifs sont menacés ou frappés comme Juifs où que ce soit dans le monde. Ou bien Français Juif, quand c'est la France, le destin de la France qui est en cause dans la conjoncture nationale ou internationale. Je n'imagine pas une seconde que je puisse faire prévaloir ma qualité de Français sur celle de Juif ou inversement. Je les éprouve indissociables en moi. Il se peut que dans l'avenir le cours de l'histoire fasse que ma qualité de Juif, avec ce qu'elle implique de liens fraternels et indissolubles avec le sort d'Israël, et ma qualité de Français - avec ce qu'elle comporte d'appartenance et d'adhésion au destin de la France - se trouvent en opposition. Les intérêts de la France et ceux de l'État d'Israël peuvent ne pas coïncider toujours sur tous les points. J'aurai alors à vivre, comme Juif et comme Français, cette situation contradictoire née de ma condition complexe de Juif et de Français. Ces jours-là ne seront pas faciles ni heureux. Mais depuis quand le fait d'être Juif, en France ou ailleurs - y compris en Israël, -a-t-il été une promesse ou un gage de bonheur ici-bas?
Solidarité avec Israël
Que la communauté juive de France doive être fraternellement solidaire du sort de l'État d'Israël est une évidence. Quant à l'expression politique de cette solidarité, elle ne me paraît pas poser de problème. Tout d'abord, il appartient aux instances et aux mouvements communautaires de manifester fortement et publiquement leur solidarité avec Israël. Quant aux Juifs, en tant qu'individus, tous - au moins ceux qui sont conscients de leur judéité - éprouvent cette solidarité, quelle que soit la diversité de leurs opinions politiques. Dès lors, il ne peut y avoir en France un parti ou un « lobby » juif (terme détestable) pour la simple raison que la seule condition juive ne saurait engendrer une identité de choix politique pour tous. Le pluralisme des partis - et la diversité des tendances au sein de chaque parti - permettent d'ailleurs à chaque Juif français de censurer l'homme ou le mouvement politique dont les actes ou les déclarations se révèlent hostiles ou indifférents à la sécurité de l'État d'Israël. Pareille attitude est normale en démocratie. Tout électeur arrête son choix politique selon ses convictions et ses intérêts. Il ne saurait en être autrement pour les électeurs juifs. Mais prétendre tirer d'une réaction commune la preuve de l'existence d'un prétendu vote juif, et vouloir l'organiser politiquement, me paraît une entreprise erronée et vouée à l'échec.
Lutte contre tous les racismes
Pour les Juifs, il ne saurait y avoir hésitation ou passivité quand il s'agit du combat pour les droits de l'homme, et en particulier de la lutte contre le racisme qui n'est qu'un de ses aspects. Sauf à démentir toute leur tragique histoire, les Juifs ne peuvent être qu'aux côtés des victimes, jamais du côté des bourreaux. Or l'on est objectivement du côté des bourreaux quand on choisit la voie commode du silence, ou la voie profitable de la compromission. Ne pas lutter contre les persécutions des « refuzniks » - ou des dissidents (même combat)- en U.R.S.S. est une trahison pour un Juif. S'accommoder des tortures en Argentine, en Uruguay, au Chili, est une lâcheté pour un Juif. Ne pas s'opposer à l'apartheid est une démission pour un Juif. Et fermer les yeux, quand bien même il s'agirait de l'État d'Israël, sur toute atteinte aux droits de l'homme, est un reniement pour un Juif. Je m'étonne seulement - et m'afflige souvent - que cette vérité élémentaire - hors le respect absolu des droits de l'homme, pas de salut pour les Juifs- ne soit pas perçue par tous les Juifs. Et qu'ils n'en tirent pas en actes toutes les conséquences. C'est au moins la prise de conscience de la spécificité de la condition juive que la force de son expression qui marque de façon remarquable la communauté juive actuelle. Peu importe que cette affirmation de la spécificité juive s'exprime dans le domaine social, culturel ou par des manifestations éclatantes de solidarité avec Israël. L'essentiel est que les Juifs proclament hautement leur droit à la différence, c'est-à-dire à la judéité. Cette attitude des Juifs s'inscrit d'ailleurs dans le mouvement plus général qui conduit toutes les minorités à refuser de se soumettre au modèle culturel imposé par la majorité - ou le pouvoir central. Nul doute que les institutions communautaires doivent favoriser et assumer ce qui est moins un renouveau juif que l'affirmation nouvelle d'une vérité constante: l'originalité de la condition juive.
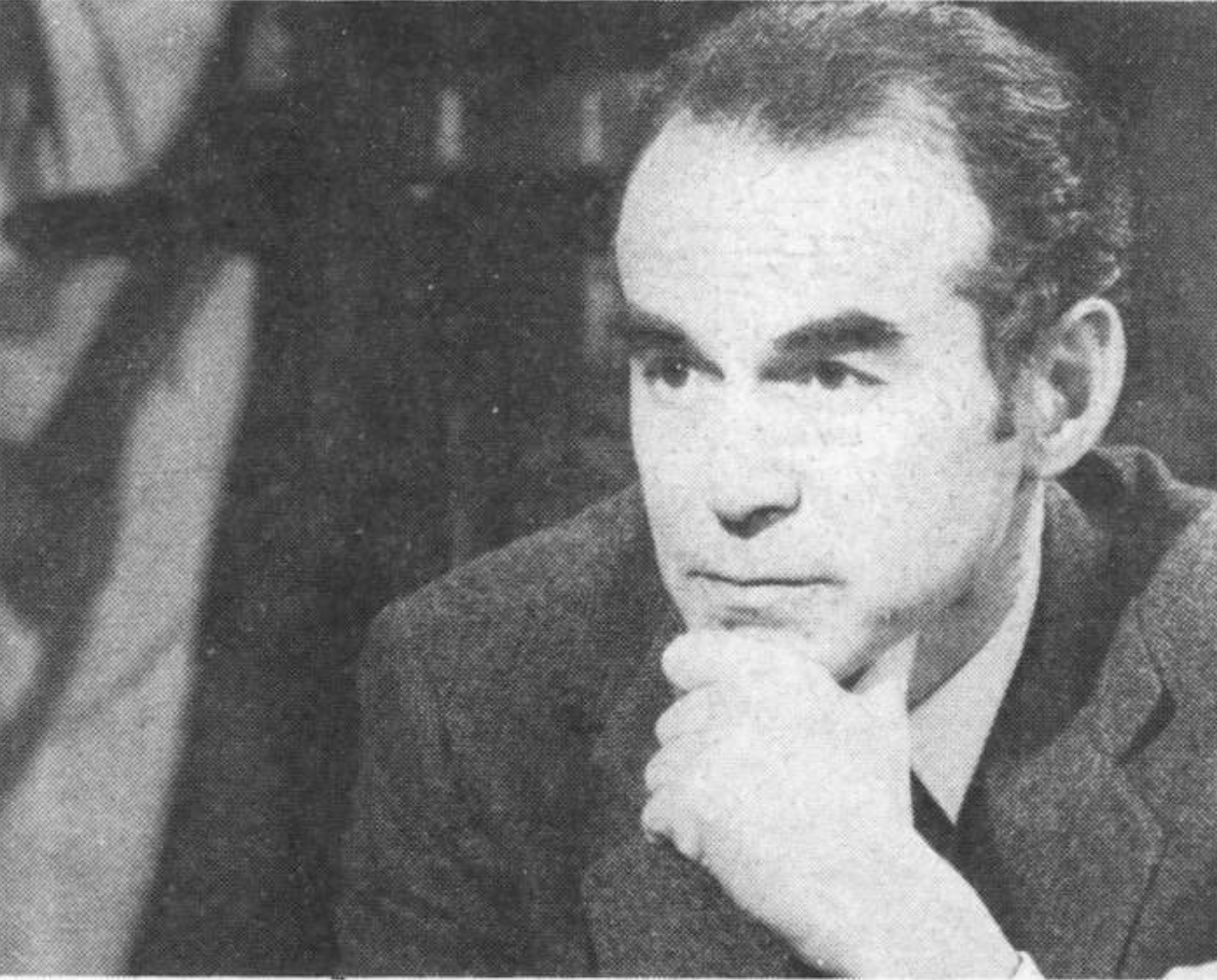
© Atlan/Sygma











